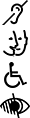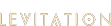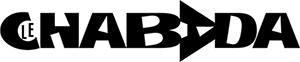© Édouard Beau
Après trente de carrière et vingt albums au compteur, Titi Robin fait une révolution. Au sens mathématique du terme. Il boucle la boucle, et revient à son point de départ. Enfin presque. S’il revient à l’électricité de sa prime jeunesse pour ce nouveau «Rebel Diwana», le guitariste angevin n’en oublie pas pour autant tout le bagage accumulé dans ses pérégrinations aux quatre vents. Titi Robin raconte donc toujours la même histoire, construite sur une même syntaxe, mais avec un vocabulaire renouvelé. Et ça change quand même pas mal de choses… Explications avec l’intéressé.
«Rebel Diwana» est vraiment ton premier disque enregistré avec une guitare électrique ? Ça semble hallucinant…
Adolescent, j’ai un peu joué de la guitare électrique, mais c’était bien avant de devenir professionnel. Ensuite, l’acoustique s’est assez vite imposée à moi, et c’est devenu ce pour quoi j’ai été connu. Mais au milieu des années 80, on avait monté le groupe Johnny Michto avec deux amis de la Roseraie, Abdelkrim Sami et Abdellah Achbani. J’y jouais d’un bouzouk branché sur un pédalier de guitare, et Karim beuglait dans le micro ! On avait un matos pourri, ça sonnait comme un garage band ! Dans l’esprit, c’était même très punk. J’aimerais d’ailleurs beaucoup réentendre les cassettes qu’on avait enregistrées à cette époque avec le trio. Si quelqu’un à ça ?? Pour l’anecdote, on répétait dans une petite cave, dans un parking sous-terrain, juste à côté d’un autre groupe d’Angers qui débutait sa carrière : Les Thugs. Johnny Michto n’a jamais vraiment décollé. A l’époque, personne n’avait entendu parler de «musiques du monde». Le raï n’était pas encore arrivé, il n’y avait pas encore de groupes comme Les Négresses Vertes qui allaient populariser ces musiques. Ensuite, j’ai commencé à me faire un nom, d’abord en jouant du oud, puis surtout avec le disque «Gitans» en 1993. La suite ne sera qu’acoustique. Quand j’ai fait écouter ce nouveau disque à ma mère, je m’attendais à ce qu’elle me demande ce qui m’avait pris. Et au contraire, elle m’a dit : «Tiens, tu reviens à tes premières amours ?». C’est donc elle qui m’a fait prendre conscience la première de ce retour à l’électricité de mes tout débuts.
Finalement, tu as commencé avec un instrumentarium très «musiques du monde» (bouzouk, percussions…) pour un rendu très rock, et aujourd’hui tu utilises un instrumentarium très rock (guitare électrique, basse, batterie) pour un rendu qui ressemble finalement à ce que tu joues habituellement. Ce sont juste de nouveaux outils en fait ?
Exactement, c’est ce que j’ai voulu dès le début : utiliser des outils différents. J’ai parfois dit en rigolant que cette fois, j’avais utilisé les armes de l’ennemi. Parce que j’ai toujours eu à cœur de ne pas me laisser influencer par la culture anglo-saxonne. Je ne parle pas là en tant qu’amateur de musiques, parce que c’est bien sûr une culture très riche, que j’écoute et que j’apprécie. Je parle surtout d’un point de vue de musicien professionnel qui a toujours voulu jouer des musiques qui n’ont rien à voir avec les codes anglo-saxons, et là il existe un véritable rapport de force. C’est très difficile d’exister face à ce bulldozer. Dans mon disque précédent, «Taziri», on jouait un blues méditerranéen, qui puisait sa source au Maroc, sans faire l’aller/retour à traverser l’Atlantique. Pour montrer que c’était possible de jouer le blues avec nos codes à nous. J’ai toujours revendiqué ça, jusqu’à devenir limite têtu sur la question. Tous les disques que j’ai enregistrés, je l’ai fait avec des gens de différents pays, mais dans lesquels je me reconnaissais, que je comprenais, qui me comprenaient, avec lesquels c’était donc facile de jouer. C’est plus facile et évident pour moi de jouer avec des musiciens gitans ou berbères que si je devais jouer du rock ou du jazz américain. Donc «utiliser les armes de l’ennemi», c’est une boutade. Mais je dois bien admettre qu’il y a un véritable confort de jeu de pouvoir utiliser des instruments qui sont nés avec l’électricité. Quand je jouais sur mon bouzouk électrifié, il fallait beaucoup bricoler. C’est un instrument acoustique à la base, qu’on devait amplifier. Ça ne se fait pas si facilement. Techniquement, ce sont beaucoup de contraintes. Ça entraine une certaine fragilité. Une guitare électrique, quand tu veux la faire sonner, ça sonne ! Et j’avais besoin de cette puissance sonore pour exprimer ce que je voulais sur ce disque.
Quel a été le déclic ?
Je pense que ça a toujours été dans un coin de ma tête. Mais quand tu t’engages dans un nouveau projet, c’est un peu comme pour un fleuve qui grossit à partir de confluents. Là aussi, je crois qu’on se trouve à faire telle ou telle chose pour différentes raisons qui n’ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui se rejoignent au même endroit à un instant T. Ici, il y avait des raisons politiques et la violence de la société qui me donnent envie de faire plus de bruit. Il y avait aussi des raisons purement techniques. Quand tu joues d’une guitare acoustique à la maison, tu obtiens un son bien particulier, dans lequel tu mets toute ta vie. Il n’y a aucun filtre. Tu entends ce que tu joues, ce que tu es. Puis quand tu te retrouves à jouer la même chose sur une scène, tu ne retrouves plus jamais ce son, parce qu’il est tributaire de l’acoustique de la salle, du matériel, etc. Chaque date est donc un défi pour essayer de se rapprocher au maximum du son originel de la composition. Ces fluctuations sont beaucoup moins importantes avec une guitare électrique. Je peux donc emporter mon son avec moi sur toutes les scènes. Quand j’ai une envie de puissance, j’ai juste à monter le volume de mon ampli, et c’est parti ! C’est une chose dont j’ai souvent parlé avec Toumani Diabaté, le jour de kora malien. On jouait ensemble dans des festivals WOMAD en Océanie. Ces festivals sont normalement censés être une célébration des musiques du monde entier, mais techniquement rien n’est prévu pour un oud, un bouzouk ou une kora. Dès qu’on montait sur scène avec nos instruments, la galère commençait pour nous et pour les techniciens ! C’était la fête du larsen ! (rires)
Il n’y pas que l’électricité qui étonne dans ce disque. Tu chantes aussi pour la première fois ?
J’avais déjà un peu chanté sur le disque «Kali Gadji» en 1998. Mais je n’avais pas trouvé l’essai très concluant, donc je n’avais pas continué. Je n’ai pas souvent chanté, mais j’écris depuis toujours. En 2014, j’ai enregistré un disque avec l’acteur Michael Lonsdale qui lisait ma poésie. Sa voix était un vrai stradivarius. Et ça m’a donné envie de m’y remettre. Je trouvais que le moment était venu d’assumer. Mais comme je ne suis pas un chanteur au départ, j’ai voulu qu’il y ait un autre vrai chanteur dans le groupe. C’est Shuheb Hasan, un chanteur indien qui chante donc des traductions de mes textes en hindi. Il est aussi très fort pour improviser, à la manière d’un musicien soliste. Et moi, je déclame en français, plus que je ne chante vraiment. C’était important pour moi qu’il y ait ces trois niveaux de voix.
Tu as travaillé avec Alain Bashung en 2005/2006. La façon dont tu poses ta voix sur ce disque m’a un peu fait penser à lui. C’était volontaire ?
Tu n’es pas le premier à me faire remarquer cette similitude. Ce n’était pas conscient, mais c’est évident que cet homme m’a marqué. Je me souviens quand j’allais répéter chez lui, juste en duo, son phrasé était vraiment très impressionnant. Je ne l’avais jamais relevé à ce point, avant d’avoir à jouer avec lui. Il était d’une précision et d’une exigence extrêmes. Il travaillait beaucoup ça en amont avec ses paroliers. Donc je n’ai pas cherché à l’imiter, et je sais bien que le résultat n’est pas du tout à son niveau, mais c’est évident que cette expérience m’a nourri.
Après trente ans de carrière, tu avais besoin de te lancer de nouveaux défis ?
C’est sûr que je me mets en danger sur ce disque. Je ne l’ai pas tellement choisi. Il y a des artistes qui revendiquent de se mettre régulièrement en danger pour se surpasser, mettre du piment dans leur vie, ou autre. Je ne vois pas du tout les choses comme ça. Il y a des choses que je veux atteindre, que je veux exprimer. Parfois ces choses impliquent que je me mette en danger. Donc j’y vais. Mais pas pour le simple plaisir de me mettre en danger, mais vraiment parce que la musique l’exigeait. C’est comme si tu es amoureux de quelqu’un qui est de l’autre côté d’une rivière, tu dois la traverser pour la rejoindre. C’est la vie. Je sais qu’une partie de mon public ne va pas aimer cette nouvelle direction. Et ils ont bien le droit. Ils cherchent un timbre précis dans ma musique qu’il ne retrouveront pas là. C’est comme si je leur proposais une très bonne viande alors qu’ils veulent manger du poisson. Donc c’est normal. Je sais qu’une autre partie aura besoin de temps pour apprivoiser ce disque. Donc là ça sera intéressant de voir comment ils vont réagir. Et j’espère bien sûr que cet album électrique donnera envie à de nouvelles personnes qui n’avaient encore jamais écouté mon travail de s’y intéresser.
« Rebel Diwana » (Suraj / Molpé Music) est disponible depuis le 30 mars 2018.
Site officiel de Titi Robin: www.titirobin.com